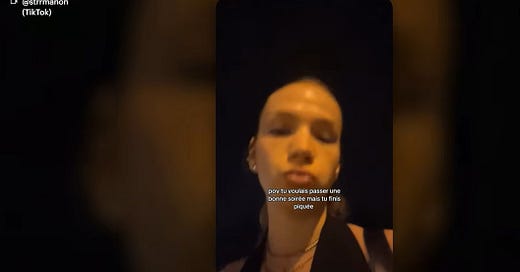Pique ta gwer
Quel sens peut bien avoir l'épidémie de piqûres qui a eu lieu le 21 juin dernier, trois ans après le premier épisode de la série, en 2022 ?
Cette année, les lendemains de fête de la musique n’ont pas vraiment chanté : outre les désormais habituelles agressions, classiques (dix contre un) ou au surin, la casse et la crasse, on répertoria, également, le retour des piqûres sauvages. Apparemment, des appels en ce sens avaient été lancés sur les réseaux sociaux, appels qui furent visiblement suivis d’effet : le 21 juin dernier, 145 personnes ont été piquées en France. Sur les 25 comptées en Ile de France, 24 étaient des femmes. Ce n’est pas vraiment une première, mais la répétition, concentrée sur une soirée, d’un épisode ayant déjà eu lieu en 2022, étalé sur les mois estivaux.
Il y a trois ans en effet, même si tu l’as probablement oublié tant est dense et redondante l’actualité de la connerie, on avait déjà recensé en France 2100 plaintes pour piqûres, concernant essentiellement les femmes. Grenoble, Béziers, Tours, Saint-Malo, Rennes, Périgueux, l’Ile de France, Lille, Strasbourg, Nancy, Lyon, Bastia, Besançon, Valence, Toulouse, l’ensemble du territoire national était concerné, mais pas uniquement : au-delà de nos frontières, en Espagne, en Angleterre, ça piquait aussi. L’Internationale de la piquouze, en quelque sorte.
capture d’écran vidéo Le Point
“Psychose” ????
En 2022, exactement comme le 21 juin dernier, aucun motif apparent à ce geste : pas de drogue ou de produit injecté, pas de vol, pas de viol. Pourtant, si le piqueur ne retire aucun bénéfice matériel ou sexuel de son geste, il n’en demeure pas moins que les piqûres suscitent un indéniable effet collectif. Lorsqu’ils veulent désigner celui-ci, sans doute parce qu’il s’inscrit dans le registre de l’esprit, les journalistes usent (et abusent) du terme de “psychose”. Ce faisant, ils induisent, qu’ils le veuillent ou non, une inversion implicite de la causalité : il est sous-entendu dans leur discours que la matrice des piqûres serait la “psychose” elle-même, sorte de fantasme collectif déclenché à partir de quelques incidents isolés sans signification particulière.
Visiblement, les médias ignorent le sens du terme, qui désigne une pathologie psychique caractérisée par l’occultation et la torsion du réel : le psychotique délire, en ce que son discours (intérieur et extérieur) refuse la prise en compte de tout ce qui pourrait contrarier ses fantasmes. En un mot, il refuse de prendre en compte le réel (et de fait, s’il y a bien une chose contrariante en ce bas monde, camarade, c’est le réel…) Chez le psychotique, faute des contradictions et des limites normalement apportées par l’extérieur, tout l’espace psychique est donc occupé par le fantasme et la pulsion.
Appliqué à cette muy misteriosa affaire de piqûre, l’usage du terme psychose signifie donc, implicitement à tout le moins, que les jeunes femmes piquées auraient été saisies d’une forme de délire collectif, fantasmant les piqûres pour exprimer, sans doute, leur mal être face à une époque particulièrement anxiogène. Dans cette optique, les journalistes traitant du sujet ne manquent pas de rappeler, en guise de confirmation empirique, que l’histoire comporta des épisodes du même genre, phénomènes sporadiques apparaissant puis disparaissant spontanément, quelque part entre rumeur, autosuggestion et hallucination de masse. La presse aime ainsi à se référer au 19ème siècle, durant lequel Paris connut un épisode de piqûres visant, là aussi, uniquement les femmes. Comparaison et raison, nonobstant, vont rarement de pair : lors de cet épisode qui se déroula à Paris uniquement, il n’y avait qu’un seul piqueur. Les piqueurs d’aujourd’hui au contraire sont multiples et les piquées éparpillées aux quatre coins de la France. Autre élément de différenciation, la répétition, la session de la semaine dernière constituant le deuxième épisode d’une série qui risque fort de se poursuivre dès lors que certaines conditions seront réunies (on voit ça plus bas).
Le terme de psychose apparaît donc inadapté, et son usage semble exprimer, plutôt qu’une volonté de comprendre, un besoin quasi infantile de se rassurer : dis, hein c’est un truc imaginaire, hein y a pas de quoi s’inquiéter, dis ? Surtout, ne pas voir la multiplicité des auteurs, la simultanéité en différents lieux, la répétition. Ne pas voir le réel, pour éviter de comprendre (quand on comprend, il est vrai, on est pas vraiment rassuré).